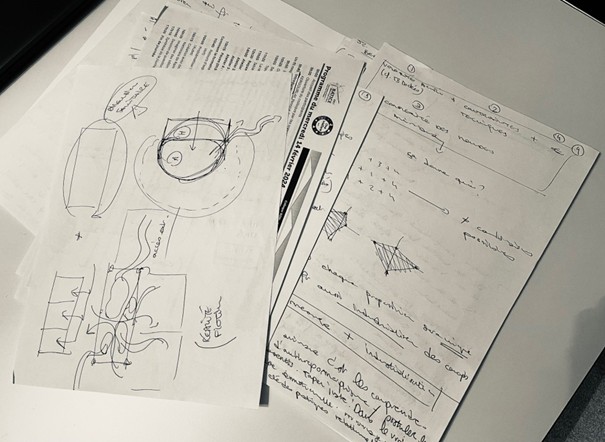Quand j’ai pointé du doigt l’idée que l’on pouvait aller encore beaucoup plus loin que les travaux qui ont été présentés, l’on m’a dit « je préfère voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide ». Je dis que « plus le verre sera vide, plus les démarches seront fortes ».
Il est impératif de concrétiser encore plus l’ensemble de nos démarches à la croisée de nombreuses disciplines pour améliorer les conditions d’élevage, tant du côté de l’Homme que de celui de l’Animal, à travers des actions toujours plus concrètes. L’objectif pour les principaux concernés est double ; se sentir mieux et se sentir compris (à la fois pour l’Homme et pour l’Animal). Concernant les éleveurs, les médias nous rappellent sans cesse les lourdes et diverses responsabilités que ces professionnels portent sur leurs épaules, bien que celles qui nous préoccupaient principalement durant ces deux jours, est leurs responsabilités envers les animaux d’élevage, qu’ils détiennent, et dont ils contrôlent la vie (puis la mort). Effectivement, loin d’être anecdotique, c’est le statut de l’animal (de rente) qui renvoie le plus souvent les représentations les plus mauvaises de la profession au consommateur et à la société. L’image même de l’élevage peut en être profondément impactée, et à l’autre bout de la chaîne, reste un sentiment impuissance à épauler.
Il s’agissait d’interroger, à travers le prisme de plusieurs disciplines représentées par des éthologues, des chercheurs, des ergonomes, des agriculteurs, des agronomes, des vétérinaires, des zootechniciens, une architecte… comment pourrait évoluer prochainement le bâtiment d’élevage, point de rencontre entre l’homme et l’animal, lequel est un cristalliseur de bien des enjeux.
On se rend bien vite compte de la dimension antinomique de nombreux concepts. A priori, les conditions d’améliorations de détention des animaux d’élevage passent par la dégradation de principes zootechniques et impacteraient la rentabilité financière de l’exploitation. L’objectif est grand, puisqu’il semble n’admettre que des compromis.
Alors, comment favoriser l’exploration de la complexité ? Qu’est ce qui fait que l’on travaille bien dans un bâtiment ? Les deux termes « bien-être animal » et « élevage » sont-ils compatibles ? Comment admettre rechercher des états émotionnels majoritairement positifs pendant la vie en élevage quand la finalité est la mort ?
Dans cette densité de connaissances scientifiques et de réflexions philosophiques, sociétales et sociologiques, il s’agit d’abord de déconstruire l’héritage culturel que nous perpétuons parfois malgré nous. Comment relier un sujet si complexe à des propositions concrètes ? L’idée de réunir un panel varié de professionnels et d’experts est indispensable, riche et risquée. Aussi pertinentes et documentées que sont toutes les recherches et travaux présentés ; il faut parfois accepter de remettre en question le bien fondé de chacune des démarches, les interroger encore et encore sous différents angles de vue. Mais c’est en s’aventurant à la confrontation, en sortant d’une certaine zone de confort, que naissent les possibilités de s’engager dans une nouvelle transition. Ensemble.
Comme dans tous projets, il y a autant de projets que de clients. Autant de solution que d’architectes (concepteurs), et un agriculteur à toujours des choix à faire, sinon les bâtiments seraient, in fine, tous les mêmes. Dans ce type de projets, nous nous situons entre l’industrialisation et le sur-mesure.
L’approche par le prisme du bâtiment permet à la fois d’avoir un impact sur l’éleveur, l’animal, l’entreprise et le consommateur. Bien que tous les maux relatifs à l’agriculture ne puissent être résolus que par cet unique biais, nous prenons conscience que le bâtiment d’élevage est porteur de nombreux espoirs.
Evidemment le bien-être animal ne peut être traité à part des autres sujets et ne va pas sans les conditions suivantes que sont le rendement, l’environnement et la conscience écologique, les réglementations et normes en vigueur, les possibilités financières, les saisonnalités, les partis-pris politiques… mais les pistes à explorer sont nombreuses. L’on constate que le sujet n’en est encore qu’à ses prémices tant les possibilités intellectuelles et techniques qui s’offrent à nous sont grandes. A tout point de vue, il faut se saisir de ces enjeux.
En deux jours de colloque sur le thème du « bâtiment », je déplore le manque de références à l’architecte, pourtant esprit de synthèse, chef d’orchestre porteur d’une vision globale et disposant de tous les outils nécessaires à la concrétisation d’éléments bâtis. A l’inverse, je salue l’accueil qui m’a été fait alors même que cette profession semble a priori ne pas être attendue ni sollicitée dans ce type d’évènements. Vu la multiplicité d’informations échangées et les limites de transpositions de la réflexion à la réalisation, il me semble pourtant que l’architecte est un chainant manquant dans ce domaine. Bien que, l’architecte seul, ne dispose évidemment pas de l’ensemble des compétences nécessaires au développement aussi riche et pertinent que nous pouvons envisager.
Finalement, il se trouve que les bâtiments d’élevage, pourtant considérés comme des structures simples, sont bien plus subtils à étudier quand l’on prend en compte la complexité des enjeux et des problématiques qu’ils recouvrent.
Parce que la construction d’un bâtiment d’élevage est l’une des étapes les plus importantes dans la vie d’une exploitation et dans le parcours d’un éleveur, qu’il est un outil de travail qui sera utilisé sur une période de plus de vingt ans et qu’il deviendra le lieux de vie de chaque animal jusqu’à son dernier jour, qu’il est le lieu clé des pratiques relationnelles entre l’homme et ses animaux, et qu’il illustre une pratique exposée à la vue de chaque consommateur et de l’ensemble de la société sans filtres ; il paraît plus que pertinent de poursuivre ces réflexions en allant encore plus loin pour proposer un véritable virage porteur de sens à la profession et à tous les acteurs de cette transition.
En se saisissant de la question de l’Animal, c’est bien de l’Homme qu’il s’agit.